-

Leem
Dispositif médical, Essais cliniques, Innovation, Recherche
-
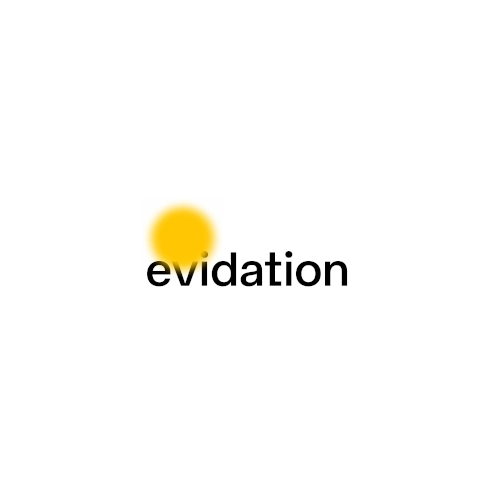
Evidation Health
Donnée de santé, e-santé, Essais cliniques, Objets connectés
-

Bepatient
Données de santé, Essais cliniques
-

Ipsen
Oncologie, Recherche et développement
Estimé entre 1 et 3 milliards de dollars selon les études, le coût de R&D pour la mise sur le marché d’un médicament comporte de nombreux éléments, dont la mise en place des différentes phases d’essais cliniques. Et pour ces étapes, les patients restent encore au coeur du processus. Leur recrutement s’avère alors un point clé. L’étude du Leem (Les Entreprises du médicament) sur l’attractivité de la France pour la recherche clinique internationale, présentée début 2017, faisait état d’une “vites
…